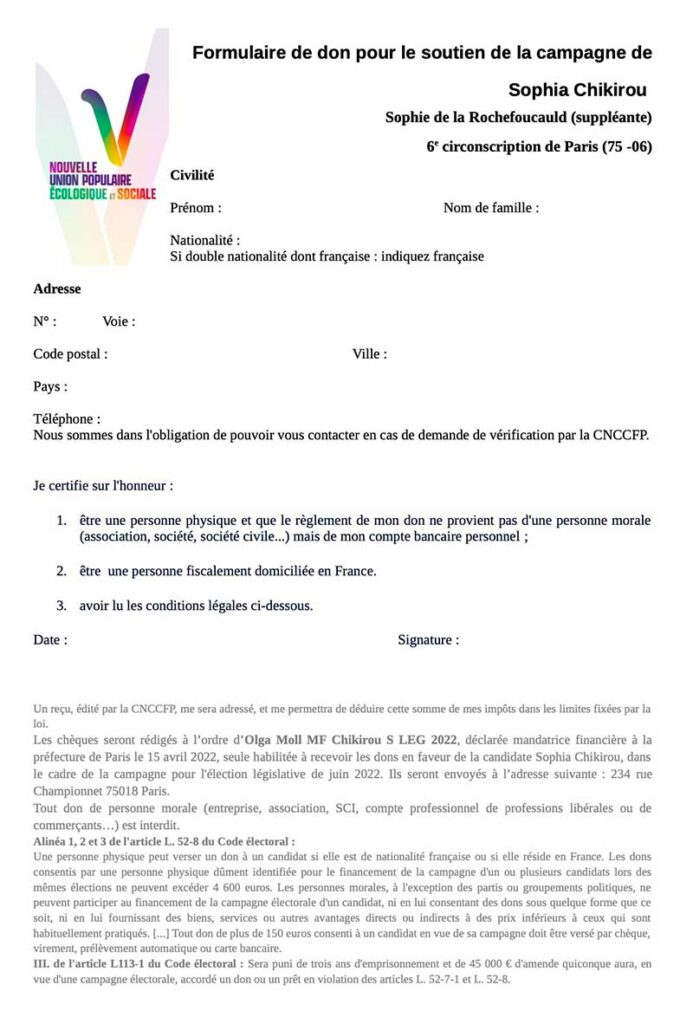Le 11 juillet 1995, l’armée serbe de Bosnie, dirigée par le général Ratko Mladić, exécutait plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans après la chute de l’enclave de Srebrenica.
Protégée en théorie par les casques bleus néerlandais, la ville fut le théâtre du pire massacre commis en Europe depuis 1945. En 2007, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu ces faits comme un génocide. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) l’avait déjà établi lors des procès de Radislav Krstić, puis de Radovan Karadžić et Ratko Mladić.
À Srebrenica, on n’a pas tué des civils dans la confusion d’un champ de bataille. On a sélectionné, méthodiquement, les hommes musulmans, parfois adolescents, parfois très âgés, pour les assassiner en quelques jours. Le jugement Krstić de 2001 indique explicitement que l’objectif des forces serbes était de “mettre fin à la présence des musulmans à Srebrenica”, dans un projet de purification ethnique à motivation identitaire et religieuse.
Le terme “islamophobie” n’était pas encore d’usage courant à l’époque, mais la mécanique était déjà là : la haine contre les musulmans comme ciment de mobilisation nationaliste. La propagande serbe les désignait comme “Turcs”, étrangers à la nation, ennemis de l’intérieur. La mémoire ottomane déformée servait à justifier l’exclusion, puis l’extermination. La destruction des mosquées, des cimetières et des noms musulmans accompagnait celle des corps.
Les « musulmans » : une minorité européenne stigmatisée
Ce que Srebrenica rappelle, avec une brutalité irréfutable, c’est que l’islam n’est pas un corps étranger à l’Europe. En Bosnie-Herzégovine, les musulmans sont présents depuis plus de cinq siècles. L’islam européen ne vient pas des migrations du 20e siècle, mais de l’histoire impériale, des frontières mouvantes, des identités croisées de l’espace balkanique.
Au-delà des Balkans, les présences musulmanes en Europe sont bien plus anciennes et enracinées qu’on ne le dit. En Bulgarie, en Albanie, au Kosovo, en Macédoine du Nord ou en Russie (Tatarstan, Tchétchénie), des millions de citoyens européens sont musulmans. La minorité tatare de Lituanie y est implantée depuis le 15e siècle.
Aujourd’hui, les musulmans représentent environ 25 à 27 millions de personnes dans l’Union européenne selon le Pew Research Center (2017). La France en compte environ 5 à 6 millions selon les estimations (sans recensement officiel).
En France, la présence musulmane ne peut être réduite à une immigration récente ni traitée comme un corps étranger. Elle s’inscrit dans une histoire pluriséculaire, faite de circulations, de liens coloniaux mais aussi d’enracinements profonds. Dès le Moyen Âge, des échanges intellectuels, commerciaux et diplomatiques liaient le monde musulman aux royaumes européens, y compris la France. À partir du 19e siècle, l’intégration de vastes territoires majoritairement musulmans dans l’Empire colonial français, du Maghreb à l’Afrique subsaharienne, en passant par le Levant, a rendu cette présence massive, quotidienne et constitutive de la République elle-même.
Des centaines de milliers de musulmans ont combattu sous l’uniforme français lors des deux guerres mondiales, souvent au prix de leur vie, sans que leurs sacrifices n’ouvrent les portes d’une égalité réelle pour leurs descendants. Ces derniers, pourtant français, souvent nés en France, y vivant depuis plusieurs générations, sont encore perçus par certains discours politiques et médiatiques comme des éléments extérieurs, suspects ou à assimiler de force. Nombre d’entre eux, bien que non croyants ou non pratiquants, continuent d’être renvoyés à une altérité religieuse fantasmée, sur la seule base de leur nom ou de leur origine supposée.
Ainsi, la citoyenneté des Français considérés comme musulmans reste sans cesse mise à l’épreuve. Cela témoigne d’un déni profond : celui d’une histoire partagée et d’un présent commun.
Pourtant, les musulmans européens sont la minorité religieuse la plus discriminée du continent. Le rapport 2022 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) révèle que 39% des musulmans interrogés ont subi une forme de discrimination dans les cinq années précédentes, contre 29% pour le reste de la population issue de minorités ethniques. Les femmes portant un foulard sont particulièrement ciblées. Dans plusieurs pays, l’islam est explicitement visé par des lois, des dissolutions administratives ou des discours politiques assimilant foi musulmane et menace pour la République. La police est trop souvent utilisée pour cibler les personnes dont les descriptions dans certains procès-verbaux n’hésitent plus à qualifier « d’apparence musulmane » et les « contrôles au faciès » sont totalement banalisés voire justifiés.
Plus jamais ça
Srebrenica n’est pas une exception historique figée. C’est un avertissement. L’histoire montre où mène la stigmatisation constante d’une population religieuse : vers la déshumanisation, puis vers la destruction. C’est pourquoi la reconnaissance du génocide ne peut être purement formelle ou mémorielle. Elle nous oblige à interroger le présent.
La montée de l’extrême droite en Europe, la banalisation du racisme sous couvert de laïcité, les fantasmes sur l’islamisation ou les « grands remplacements », ne sont pas sans lien avec cette histoire. Ils nourrissent une matrice politique qui, en d’autres temps, a rendu possibles les pires crimes.
Rappeler que des musulmans ont été exterminés parce qu’ils étaient musulmans, en Europe, il y a moins de trente ans, c’est refuser qu’on puisse aujourd’hui en douter, ou l’oublier. C’est défendre une mémoire qui dérange, mais qui protège.