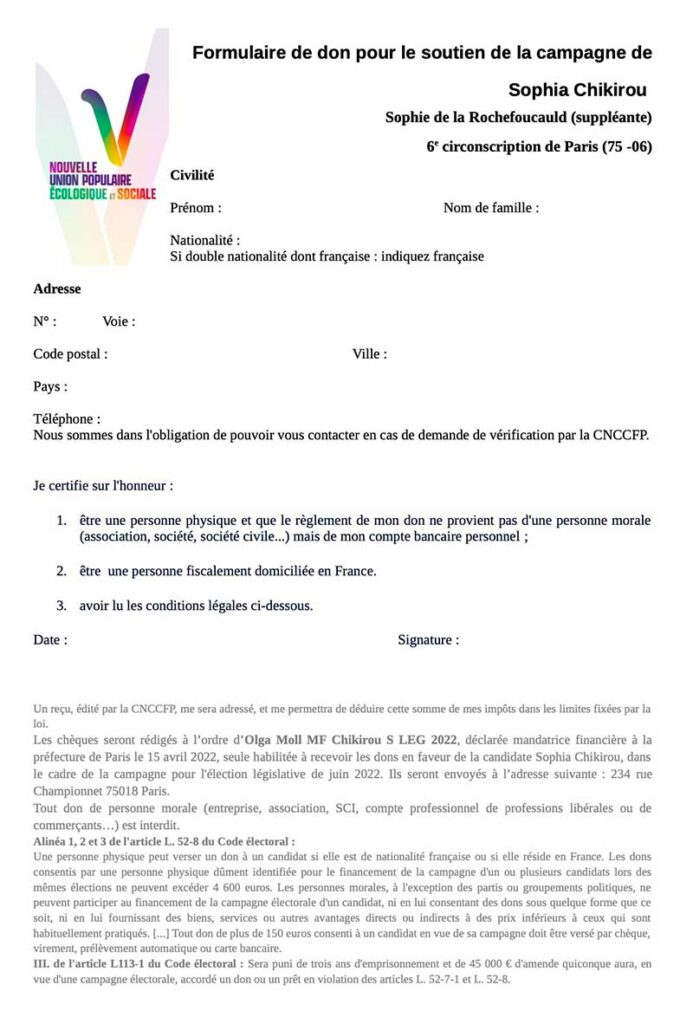L’association française d’agriculture urbaine professionnelle (AFAUP) recense plus de 300 structures professionnelles aujourd’hui, contre à peine 6 il y a 10 ans. Elle compte plus de 6000 sites référencés et poursuit son travail de collecte de données. Présentant de nombreux atouts éducatifs, sociaux ou environnementaux, l’agriculture urbaine ne doit plus être mise en compétition avec l’agriculture rurale classique mais doit plutôt être vue comme un parfait complément. C’est ce que Sophia Chikirou entend porter à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du Projet de loi agricole du gouvernement qui n’est pas à la hauteur des enjeux, mais aussi via la publication d’une proposition de loi visant à développer l’agriculture urbaine.
L’agriculture urbaine, qu’est-ce que c’est ?
Il est évident que l’agriculture urbaine se caractérise avant tout par sa localisation en ville. Mais les aires urbaines ne sont pas toujours simples à définir. Une exploitation agricole située au beau milieu d’un bourg de campagne reste de l’agriculture urbaine. De plus, elle présente d’autres particularités. Elle remet en cause le lien au sol puisqu’elle peut s’exercer sur des toits, des balcons, des parkings, dans des bacs… Et contrairement à l’agriculture classique, elle ne vise pas forcément en premier lieu la production végétale ou animale, mais peut avoir d’autres vertus sociales ou environnementales très fortes. La diversité de ses formes en fait justement une autre particularité. Elle peut être marchande (comme la ferme de Gally à Saint-Denis) ou non, comme les jardins collectifs, elle peut servir à rendre des services environnementaux à la ville, elle peut aussi avoir un modèle mixte… C’est pourquoi il apparaît plus adapté de parler d’agricultures urbaines au pluriel tant les pratiques culturales, les lieux d’implantation, les statuts et les finalités visées sont variables. De cette grande variété, on peut tirer de grands bénéfices.
Une agriculture aux nombreux atouts
Pour la souveraineté alimentaire
Selon la spécialiste Christine Aubry, ex-chercheuse associée à l’INRAE et fondatrice d’un institut de recherche sur l’agriculture urbaine, que la députée Sophia Chikirou au mois de mai, l’agriculture urbaine est outil de taille pour assurer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. S’il ne s’agit pas de faire croire que l’agriculture urbaine peut nourrir tout le monde, il faut savoir que si tous les toits de Paris était consacré à l’agriculture, on pourrait assurer jusqu’à 10% de la consommation alimentaire de la ville. L’agriculture urbaine y contribue également de manière indirecte en créant des liens complémentaires avec des activités agricoles rurales. Les discours caricaturaux de la droite qui sur l’agriculture urbaine comme étant une lubie de bobos sont alors battus en brèche. Les fermes urbaines peuvent compléter leur offre avec des produits provenant des fermes rurales, et les fermes rurales disposent d’un lien direct avec un point de vente en ville. A Marseille, la Cité de l’agriculture a créé en 2018 un marché paysan dans le quartier populaire du 15ème arrondissement après avoir constaté que cette zone était un désert alimentaire au sens où n’y étaient proposés que des produits industriels et très peu de produits frais. Et ces liens entre agriculture urbaine et rurale participent à faire émerger une économie locale et des circuits courts qui sont indispensables pour assurer la transition écologique.
Pour l’environnement
D’un point de vue environnemental justement, l’agriculture urbaine rend bien d’autres précieux services à la ville. Elle permet de lutter contre les îlots de chaleur de plus en plus fréquents et violents en ville notamment grâce à l’ombre et l’évaporation d’eau qu’elle génère, mais aussi en agissant comme un puits de carbone. La désartificialisation des sols induite par l’agriculture en ville engendre aussi un renforcement de la biodiversité et une réduction de la pollution atmosphérique. En végétalisant l’espace public, elle constitue enfin et surtout une solution idéale pour traiter les sols pollués ou pour recycler les déchets urbains. Le Conseil environnemental économique et social (CESE) explique dans son avis de 2019 que « l’agriculture urbaine peut même offrir des solutions de traitement des déchets pouvant s’apparenter à un service public ». Pourtant, aucune filière digne de ce nom n’est réellement soutenue par l’Etat à ce jour et les initiatives individuelles ne suffiront pas.
Pour renouveler les générations d’agriculteurs
L’agriculture urbaine se trouve aussi être un puissant vecteur de prise de conscience des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux pour les citadines et les citadins (préservation des terres arables face à la spéculation immobilière, développement les circuits courts et produits locaux, renouvellement des générations d’agriculteurs, transition vers une agriculture biologique). Aujourd’hui, l’agriculture est fuie par les nouvelles générations. Il existe un décalage massif entre le nombre de départs, quelques 21 000 par an, et le nombre d’installations, de l’ordre de 14 000 par convention d’occupation précaire. Pas moins de 100 000 exploitations agricoles ont disparu entre 2010 et 2020. Or, l’agriculture urbaine, en rapprochant les urbains de l’agriculture, peut susciter des vocations. Le plus gros vivier démographique dans lequel nous pouvons puiser les agriculteurs de demain est en ville. Preuve que c’est possible: la moitié des agriculteurs en bio actuels ne sont pas issus du monde agricole selon un sondage de l’Agence bio de septembre 2023.
Des freins persistants ignorés par un gouvernement méprisant
Un droit rural inadapté à la ville
Outre les simagrées de réactionnaires à l’Assemblée nationale, l’agriculture urbaine butte sur des freins juridiques et politiques concrets. Logiquement, le droit n’a pas été pensé pour l’agriculture urbaine. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est le Code rural qui régit les activités agricoles. Or, les baux ruraux ne sont pas du tout adaptés à la ville. Les propriétaires fonciers les évitent à tout prix car les prix des loyers sont encadrés strictement, ces baux sont assortis d’une durée incompressible de 9 ans, et un droit de renouvellement quasi indéfini. Pour l’agriculteur, ces baux sont également très restrictifs puisqu’ils n’autorisent pas d’autres activités que l’activité agricole pure. Or, l’agriculture urbaine se caractérise par son aspect hybride, souvent indispensable à sa viabilité et son adaptation au milieu urbain. Par conséquent, l’écrasante majorité des agricultrices et agriculteurs urbains souscrivent à des conventions d’occupation précaire, par essence peu protectrices.
Ce statut protecteur est d’autant plus difficile à obtenir que les activités agricoles urbaines ne sont pas considérées comme telles en droit. En effet, pour être considéré comme étant agriculteur, et ainsi bénéficier de la couverture de la mutualité sociale agricole (MSA), il faut remplir une condition de « surface minimale d’assujettissement »(SMA). En d’autres termes, il faut avoir une exploitation suffisamment grande pour qu’elle soit considérée comme sérieuse, et donne donc accès à une protection sociale et au statut d’agriculteur. Évidemment, il est plus compliqué d’avoir une grande exploitation en ville qu’en zone rurale. En Seine-et-Marne par exemple, la SMA est fixée à un hectare. Comment imaginer une exploitation d’une telle envergure en zone urbaine ? C’est impossible. On a donc la quasi-totalité des micro-fermes urbaines de France qui ne peuvent pas être affiliées au régime de la mutualité sociale agricole.
Un projet de loi agricole et une droite politique à côté de la plaque
Après la crise agricole et la colère justifiée des agriculteurs, après des mois de concertation et d’atermoiements, le gouvernement a enfin présenté début avril son projet de loi censé assurer la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations d’agriculteurs de notre pays. Il a été examiné en mai à l’Assemblée nationale en première lecture. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il manque totalement sa cible. En plus de torpiller le droit de l’environnement et encourager uniquement un modèle d’agriculture productiviste, il n’évoque pas une seule fois la question du revenu des agriculteurs ni même le développement de l’agriculture biologique, et encore moins celui de l’agriculture urbaine. Pire encore, tous les amendements sur le sujet ont fait l’objet d’un mépris consternant de la part des membres du gouvernement et parlementaires de droite qui témoigne de leur méconnaissance sur le sujet, restant persuadé que l’agriculture en ville est l’ennemi de l’agriculture rurale. A moins qu’il ne s’agisse que d’une ruse électoraliste…
Une bataille à mener pour transformer notre modèle agricole
Reconnaître chaque agriculteur
L’agriculture urbaine ne révolutionnera pas à elle seule notre modèle agricole. Mais elle en porte les germes. C’est pourquoi il est temps d’arrêter de la prendre de haut et de commencer à l’encourager franchement. Pour cela, il faut commencer par reconnaître le travail de ces agriculteurs en les rendant éligible à l’affiliation à la MSA soit en abaissant les seuils de superficie, soit en créant des seuils différenciés qu’on se trouve en zone rurale ou en zone urbaine.
Planification territoriale uniformisée
Ensuite, pour garantir son développement, il faut planifier à l’échelle nationale. Aujourd’hui, les collectivités s’emparent de manière beaucoup trop hasardeuse et différenciée de l’agriculture urbaine. La ville de Bordeaux a révisé dès 2016 son PLU afin de permettre des changements de destination d’occupation des sols. La même année, Lyon a intégré un coefficient de 30% de végétalisation de toute nouvelle construction. La ville de Grenoble vient également d’adopter une nouvelle stratégie de développement de l’agriculture urbaine professionnelle et citoyenne pour 2023-2026. Il paraît donc logique d’uniformiser ces pratiques en prévoyant de manière obligatoire dans des documents d’urbanisme, par exemple les PLU, les conditions de développement de l’agriculture urbaine et en fixant un taux de terrains y étant adaptés.
Soutenir la formation et la recherche
Il est aussi urgent de mieux former les professionnels de l’agriculture aux enjeux et aux spécificités de l’agriculture urbaine, et d’en former davantage. Christine Aubry a rappelé lors de son audition qu’il n’existait “pas de vraie filière professionnelle avec des métiers dans l’agriculture urbaine”. L’actuel Ministre n’est à l’évidence pas du tout intéressé par ces questions. Il existe bien quelques initiatives éparses comme l’École du Breuil dans le 12ème arrondissement qui forment des chefs de culture ou d’exploitation, ou encore Agro paris tech qui a créé une formation d’ingénieur il y a dix ans, mais celle-ci est en danger. En tout état de cause, cela concerne un tout petit nombre de personnes, à des années lumières des besoins du secteur. Même chose concernant la recherche fondamentale ou de terrain, qui est très peu soutenue financièrement par l’État et ne peut pas évaluer précisément tous les gains potentiels que l’agriculture urbaine peut apporter à nos villes et nos sociétés.
Favoriser l’immersion dès le plus jeune âge
L’agriculture urbaine a ça de formidable qu’elle rapproche les jeunes citadins de l’activité agricole qui leur est de plus en plus étrangère et de plus en plus éloignée. Installer des jardins pédagogiques dans les écoles, visiter des fermes urbaines pour avoir un contact précoce avec la production alimentaire paraît essentiel à la fois pour former des citoyens avertis et sensibilisés aux enjeux de souveraineté alimentaire et de transition écologique et pour former les générations d’agriculteurs dont on a besoin pour assurer notre avenir. “Apprendre à cultiver comme on apprend à nager”, voilà aussi ce que peut généraliser l’agriculture en ville, au plus proche des populations.